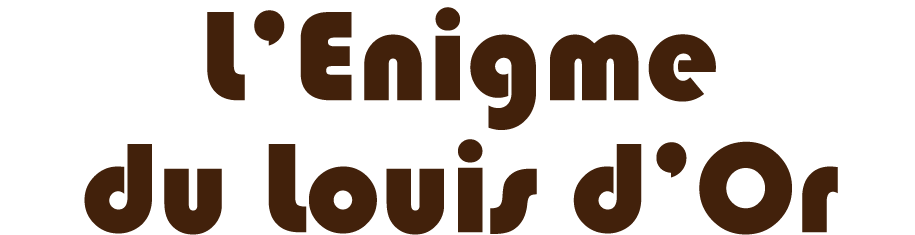Au sujet de l’auteur
En quelques mots ...
Cette chasse au trésor est le résultat du travail de deux personnes :
- Benjamin Ferré, qui a imaginé et réalisé les tableaux. Un peintre au talent exceptionnel sans qui l’Enigme n’aurait pas l’attrait visuel qu’elle a aujourd’hui. Son blog donne un aperçu de son talent.
- Moi-même, Bernard Collot, créateur de cette énigme. Initialement géologue d’exploration, je me suis, tout au long de ma vie, de par ma profession, mes voyages et mes rencontres, intéressé à la science, l’art et la philosophie. Je suis passionné par tout ce qui touche à l’être humain : ses relations avec les autres, son environnement et sa place dans le monde. Je crois en sa capacité à imaginer l’impossible pour le rendre possible. C’est de là, de cette conviction, qu’est née cette énigme.
A Benjamin et moi-même s’ajoute une autre personne sans qui rien de cela n’aurait été possible : Christelle Salgues, ma compagne. C’est elle qui, en 2006, créa le magasin qui constitue aujourd’hui le support physique de cette initiative.